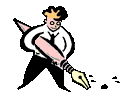|
Le Point : Selon vous, la crise sanitaire que l’on vit en ce moment représente-t-elle un tournant dans notre rapport à la mondialisation ? |
Nassim Nicholas Taleb : Il y a bientôt treize ans, quand j’ai écrit « Le Cygne noir », j’ai constaté que la fin de l’isolement et l’explosion des canaux d’information entrainent une concentration de la richesse et du pouvoir.
Cette absence d’isolement est effrayante dans le cas des maladies transmissibles, parce qu’elles peuvent se diffuser beaucoup plus rapidement. Mais l’incertitude liée à la virulence d’une épidémie majeure permet de prendre plus facilement les décisions qui s’imposent, paradoxalement. Être alarmé par le risque de pandémie n’est pas problématique !
J’ai coécrit un article, avec Joseph Norman et Yaneer BarYam, à la demande d’un responsable de la Maison Blanche, pour expliquer la chose suivante : Les médecins sont très bons pour comprendre à l’échelle d’un individu ou d’un petit groupe, mais ne comprennent pas ce qui se passe à l’échelle d’un grand groupe.
Nous avons donc préconisé de mettre une quarantaine pour les personnes ayant voyagé en Chine dans les quatorze jours précédents. Ce qu’ils ont fait quelques heures après avoir lu l’article ! Au moment où nous l’avons écrit, le 26 janvier 2020, il y avait mille cas confirmés officiellement ; à l’heure où je vous parle, trois semaines plus tard, le chiffre est officiellement de 64 000; Il ne faut jamais sous-estimer les effets multiplicatifs : et surtout, il faut éviter les comparaisons bidon en déclarant, par exemple, que plus de gens sont morts dans des accidents d’auto.
Les accidents d’auto ne sont pas multiplicatifs.
|
Mais malgré tout, ne nous inquiétons-nous pas beaucoup du coronavirus parce que c’est nouveau ? Nous nous préoccupons moins d’épidémies plus régulières comme celle de la grippe saisonnière. |
Mais
la différence avec la grippe saisonnière, c’est
qu’on est quasiment sûr que le nombre de décès
grippaux ne sera pas extrêmement important ! Pour ce
nouveau virus, nous n’avons pas cette certitude.
C’est toute la différence. Il faut raisonner par
l’inconnu, et non par le connu.
C’est une erreur
grave, parce qu’on sait qu’une grippe saisonnière ne
se multiplie pas comme le coronavirus , et si c’est
le cas, elle est bénigne. Ce qu’on a écrit, c’est
que face à un tel événement, il faut réagir pour
parer au pire. C’est une nécessité.
|
C’est effectivement ce que vous recommandiez. C’est plus ou moins ce que le gouvernement chinois a décidé de faire. Vous pensez que c’était la bonne politique ? |
Oui évidemment. Mais il aurait fallu accélérer cette politique d’isolement, et que les autres pays l’appliquent aussi.
|
Pourquoi ne pas paniquer pour toutes les maladies, alors ? |
On a
identifié les conditions dans lesquelles il faut.
Même
si on panique pour rien deux fois par an, ça vaut le
coup pour la fois où on paniquera avec raison.
|
|
|
Le coronavirus est-il un « cygne noir », comme c’est envisagé dans beaucoup d’articles, à savoir un événement imprédictible qui vient bouleverser l’environnement économique ? |
Non, pas à proprement parler. Le « cygne noir. » est quelque chose que vous n’avez pas envisagé, qui sort de nos modèles, qui est une surprise totale. A posteriori, on se dit que les choses étaient prévisibles. Rétrospectivement mais pas prospectivement. Le « cygne noir » est épistémique, et dépend de l’observateur. Ainsi, le 11-Septembre 2001 était un « cygne noir » pour les victimes [qui ne l’ont pas anticipé], pas pour les terroristes [qui l’ont préparé durant des mois]. Il dépend fondamentalement de l’observateur.
J’ai envisagé un tel cas dans mon livre Le Cygne Noir, ces phénomènes de concentration et le fait que le « winner takes all » (le gagnant rafle tout), dans les domaines culturels, économiques ou biologiques. Par exemple, dans le passé, il était très difficile pour une entreprise comme Google d’envahir toute la planète. Maintenant, elle le fait grâce au Web. Il était pratiquement certain que quelque chose du genre arriverait par un virus, qu’un virus frapperait toute la planète.
Ce virus était prévisible, si on regardait complètement les conséquences de la mondialisation. Mais il n’y a rien à craindre de la globalisation tant que l’on connaît les effets secondaires. Le problème, c’est que les gens regardent les choses sans les effets secondaires, et ce virus, c’est l’effet secondaire de la globalisation.
|
Une épidémie peut être jugulée, et des plans de santé préventifs existent. Comment expliquer qu’elle désorganise autant nos sociétés ? |
|
Le problème dans cette histoire, c’est un problème de la modernité que j’appelle le « pseudo-empirisme ». Quand les gens ne connaissaient pas la statistique, ils comprenaient la dynamique des choses. Ils savaient qu’il fallait se méfier de certaines choses, et s’ils paniquaient à tort, les coûts étaient faibles. A l’inverse, si vous ne paniquez pas alors que vous auriez dû, vous êtes morts. |
Des soi-disant spécialistes ne comprennent pas que l’absence de preuve n’est pas une preuve d’absence et commencent à faire des erreurs énormes, comme comparer le virus d’Ébola à celui de la malaria (paludisme), alors que les variables de contagion sont très différentes.
On ne peut pas de la même façon comparer la grippe au coronavirus, qui a des propriétés statistiques très différentes.
|
Mais des épidémies comme le SRAS auraient dû nous alerter, on n’en a rien tiré ? |
Nous sommes beaucoup plus connectés qu’il y a dix ans, 20 ans ou il y a 100 ans au moment de la grippe espagnole, ou encore plus loin au moment de la peste noire.
Il y a de grandes chances que cette maladie
finisse comme le
SRAS,
mais un petit risque que cela finisse différemment. Et il y a des risques qu’il ne faut pas prendre.
|
Doit-on s’attendre à une réorganisation complète du monde à l’issue de cette pandémie ? |
Il faut rester dans le cadre du « cygne noir ». Quand le monde est connecté, une ville n’est pas un village, un État n’est pas une ville. Or, l’isolement est nécessaire dans certains cas.
Plus l’espace est grand, moins il y aura d’espèces au mètre carré, et plus la concentration absurde de certains risques aura lieu. Le système du confinement est la bonne réponse. Et après la pandémie, il faudra revenir à un système décentralisé, où les gens prennent des décisions localement.
|
Un monde moins globalisé ? |
On peut aimer la mondialisation, parce qu’on aime le cosmopolitisme par exemple, ou ne pas l’aimer. Moi je l’aime, mais il faut absolument déterminer d’où les problèmes peuvent venir. Les frontières ouvertes de façon inconditionnelle sont dangereuses.
Un mécanisme de prudence veut qu’on ne puisse pas regarder les effets de cette mondialisation sans regarder aussi ses effets secondaires. On doit aller vers plus de localisme, et ça commence par les communes (villages & villes).
|
Qui sera le gagnant à l’issue de cet épisode ? |
Le localisme. Les communes doivent décider, comme en Suisse. Les États-Unis sont aussi fondamentalement localistes. En France, vous avez tout centralisé. Alors que quand vous voyez un État fédéral relativement incompétent comme aux États-Unis, les collectivités locales sont capables de palier ses incompétences. L’État, s’il fait bien, ça marche, mais sinon, ça concentre les erreurs.
La tendance mondiale est de revenir au modèle de la cité-État.
| « |
Cette maladie, le coronavirus, sera peut-être relativement facile à éradiquer, mais la prochaine sera peut-être plus grave. Le système en place doit permettre de lutter efficacement. - Nassim Nicholas Taleb |
» |
|
L’État n’est pas un niveau efficace ? |
Une personne dans un village comprend les risques qui l’affectent. Une personne à Washington s’en moque complètement, de ce risque dans le village. La raison pour laquelle le localisme marche, c’est qu’il ne faut pas trop éloigner les décideurs des conséquences de leurs décisions. Le localisme distribue les décisions et les risques. L’État central doit être un coordinateur, pas un décideur.
|
C’est un peu ce que disent les « gilets jaunes »… Oui, les « gilets jaunes » sont localistes. Il y a des choses fausses dans ce qu’ils disent, mais là où ils ont raison, c’est que les fonctionnaires sont trop éloignés du terrain. L’État n’est pas une chose théologique abstraite. Les fonctionnaires ont une rente. Le système est centralisé, les gens qui font des erreurs restent. |
Nous vivons dans un monde finalement très fragile, et le phénomène de concentration accentue cette fragilité. Un système comme le nôtre va se casser et se refaire de façon plus robuste.
Celui qui saura acheter de façon plus distribuée, et pas tout en Chine, saura survivre.
|
Vous êtes un ancien trader (courtier à la bourse). Quel est votre regard sur les banques : sont-elles plus solides qu’en 2008, comme l’affirme le gouvernement français ? |
La fragilité
liée à la dette est énorme. Les États ont
accumulé jusqu’à 20 000 milliards$ de dettes, et
ça c’est fragilisant.
Mais le sauvetage des banques s’est fait aux frais du contribuable. C’est vous qui avez sauvé les banques…
|
|
|
|
Source: 20 minutes, pour le groupe Sipa-Ouest-France: En entrevue Nassim Nicholas Taleb Professeur à l’Université de New York, le philosophe et statisticien américano-libanais est l’auteur du Cygne Noir, la puissance de l’imprévisible, un essai vendu à plus de 2,5 millions d’exemplaires dans le monde, dans lequel il théorise la survenue d’événements rares, qu’il juge imprédictibles. |
Choix de photos, collection de textes, mise en page, références et titrage par :
JosPublic |
Ci-dessous: des textes en lien direct avec le sujet:
|
|
|
|
Retour à : Plan du site - MétéoPolitique - Santé - Fiche: Grippe pandémique - Analyse - Haut de page |