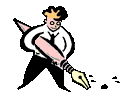|
|
|
|
Oups!
Le Fonds
monétaire international FMI
s’est
trompé sur l’austérité
Première erreur |
|
|
« |
Les effets
de l'austérité budgétaire
sur les économies des pays ont été
sous-estimés |
» |
Que
les politiques d'austérité soient mauvaises pour la
croissance et l'emploi, c'est désormais admis par la
plupart des économistes. Mais qu'elles le soient
encore plus qu'on ne le pensait, c'est ce qu'ont
découvert deux d'entre eux, et pas les moindres :
Olivier Blanchard, un Français chef économiste au
FMI, et Daniel Leigh, économiste dans la même
institution. Selon eux, l'utilisation d'un mauvais
coefficient de calcul a débouché sur une
sous-estimation des effets négatifs de l'austérité
appliqué par les
gouvernements, particulièrement en Europe.
Les deux économistes détaillent leur thèse dans un
article
( 01 )
publié le 3 janvier 2013 sur le site du
Fonds
monétaire international FMI, mais dans
une rubrique où les textes ne représentent pas la
position officielle de l'organisation.
|
«Nous
démontrons que, dans les économies développées, une
plus forte consolidation fiscale est allée de
concert avec une croissance plus faible que prévu,
écrivent-ils. Une explication naturelle est que les
multiplicateurs fiscaux étaient nettement plus haut
que ce que les prévisions estimaient implicitement.» |
Le
multiplicateur qui divise
Le
«multiplicateur» en question est le coefficient
reliant l'évolution des dépenses publiques (ou des
impôts) au taux de croissance de l'économie. Lorsque
ce coefficient est de 0,5, par exemple, cela
signifie qu'un point de dépense publique en moins,
ou d'impôt en plus, entraîne une baisse de 0,5 point
de l'activité.
|
«Il y a deux façons de le calculer,
explique Xavier Timbeau, économiste à l'Observatoire
français des conjonctures économiques
OFCE. Soit
en faisant de l'analyse historique, en regardant les
liens passés entre les politiques budgétaires et
l'activité; soit en construisant un modèle
économique et en étudiant les relations entre ses
différents composants.
Dans les deux cas, ce ne sont
pas des modèles neutres : leur construction comporte
toujours une part d'a priori, qui correspondent à
des idéologies.» |
|
Or, selon Blanchard et Leigh, le multiplicateur «de
crise» pourrait être jusqu'à trois fois supérieur à
celui des périodes «normales», utilisé jusqu'à
présent. Les deux économistes l'avaient déjà écrit
dans le très officiel rapport annuel du FMI de 2012
( 02 ):
|
«De nombreux documents, dont certains issus du
FMI, suggèrent que les multiplicateurs fiscaux
utilisés dans les prévisions se situent autour de
0,5. Nos résultats indiquent que ces multiplicateurs
se sont en fait situés entre 0,9 et 1,7» depuis le
début de la crise. En clair, l'impact de l'austérité
serait, selon les cas, de deux à trois fois plus
important que prévu.
«Jusqu'à présent, on a appliqué au temps de crise le
multiplicateur des périodes normales, explique
Xavier Timbeau.
Or, dans une crise, tout le monde
panique. Les gens ne se conduisent pas de la même
façon et personne ne peut anticiper le futur. Par
ailleurs, si l'austérité est beaucoup plus récessive
qu'on ne le pensait, cela veut aussi dire qu'une
politique de relance serait beaucoup plus efficace
qu'on ne l'imagine! |
|
«Il y
a deux FMI»
|
|
L'article de Blanchard et Leigh a fait réagir
l'économiste Paul Krugman, Prix Nobel d'économie
2008. «Le FMI était moins enthousiaste vis-à-vis de
l'austérité que les autres grands acteurs»,
rappelle-t-il sur son blog
( 03 ).
Si lui-même dit qu'il s'est trompé, cela signifie
que tous les autres[...] se sont encore plus
trompés. Et il a le mérite de vouloir repenser sa
position à la lumière des faits. La véritable
mauvaise nouvelle, c'est que bien peu d'autres
acteurs font la même chose. |
|
« |
Les
dirigeants européens, qui ont créé des
souffrances dignes de la crise de 1929 dans les
pays endettés sans restaurer la confiance
financière, persistent à dire que la solution
viendra d'encore plus de souffrance |
» |
|
|
Ne pas déduire, cependant, que le FMI remet en cause
l’austérité dans son principe. Comment le pourrait
cette institution qui a participé, notamment, à
l'élaboration du très sévère programme grec ? C’est
plutôt l’intensité des politiques d’austérité que
remet en cause le Fonds, puisque leurs effets se
révèlent plus importants que prévus. Cela rejoint
d’ailleurs la position officielle du FMI : sa
directrice générale, Christine Lagarde, réitère
( 04 ) régulièrement
ses appels à des trajectoires plus «douces» de
diminution de l’endettement et du déficit
budgétaire. |
|
«Il y
a deux FMI, la tête et le corps, estime cependant
Xavier Timbeau. En Grèce, c’est lui le plus ferme
sur l’austérité, encore plus que la Commission et
que la BCE. Quoi que disent Blanchard ou Lagarde,
sur le terrain, le Fonds applique le plan décidé
entre le pays et ses créanciers. Il faudra du temps
pour que le changement infuse dans l'institution et
en Europe. Il y a aussi le risque qu'il reste
confiné dans les hautes sphères du FMI, sans
percoler vers le terrain.»
L’Europe semble d’ailleurs s’engager dans cette
direction. Fin 2012, la Grèce a ainsi obtenu
( 05 ) un délai supplémentaire de la part de ses
créanciers. Et si le gouvernement français
s’accroche obstinément à son objectif de 3% de
déficit budgétaire pour 2013, auquel il est le seul
à croire, c’est en dépit
( 06 )
des conseils du FMI et de Bruxelles, qui prônent
désormais un «ajustement plus doux» pour le Vieux
Continent.
Après l'essorage.
 |
|
|
Un bréviaire de
l'austérité remis en cause
Deuxième erreur |
|
Rédigée
par deux économistes américains, une étude qui relie
dette et faible croissance serait fondée sur de mauvais
calculs. Féroce débat chez les spécialistes.
En
matière d’austérité, il y a la pratique et la
théorie. La première est l’affaire des gouvernements
européens qui s’y adonnent - sans autre résultat,
pour l’instant, qu'une récession continentale ; la
seconde, celle des économistes qui la justifient par
leurs travaux.
Deux
d’entre eux, les états-uniens Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff, sont aujourd’hui
en situation délicate. Selon une étude critique,
leur argumentation serait entachée d'erreurs.
|
|
Lorsque Reinhart et Rogoff publient, en 2010, un
article
intitulé «La croissance en temps de dette»
( 07 )celui-ci
est largement relayé par les médias et certains
politiques.
Se fondant sur des données historiques
internationales, «Reinhart & Rogoff» établissent une relation
entre niveau de dette et croissance du PIB.
|
Selon leur
principale conclusion, un taux d’endettement supérieur à 90%
du PIB entraînerait une baisse significative du taux moyen
de croissance, quel que soit le niveau de développement du
pays.
«Sérieuses erreurs»
L’article est reçu comme un encouragement à épurer
au plus vite la dette publique. Selon l’économiste
Paul Krugman, son influence fut «immense» : «Très rapidement, chacun "sut" que de
terribles choses arrivent lorsque la dette dépasse
90% du PIB». Certes, une critique récurrente voit
dans la faible croissance une cause du haut niveau
d’endettement, et non une conséquence. Mais les
conclusions de Reinhart et Rogoff n’en restent pas
moins un solide point d’appui pour les partisans de
l’austérité.
|
Jusqu’au 15 avril
2013 et la publication par un
étudiant en économie,
Thomas Herndon, et ses deux
professeurs, Michael Ash et Robert Pollin, d’un
article
intitulé : «Une forte dette publique freine-t-elle
substantiellement la croissance ?».
( 08 ) La publication
se présente comme une réfutation du travail de Reinhart et Rogoff. Elle y relève des erreurs dans
le traitement des données, la pondération atypique
de certaines d'entre elles, ou encore l’énigmatique
exclusion de chiffres ne cadrant pas avec leur
thèse : autant d’anomalies conduisant à de
«sérieuses erreurs».
Controverse
En réalité, selon les propres calculs du trio
d’économistes, «la croissance moyenne lorsque la
dette dépasse 90% du PIB n’est pas nettement
différente que lorsqu’elle est moins élevée». Depuis, le débat fait rage entre économistes.
«Je
n’aurais jamais rêvé qu’une part si importante de
leurs résultats ne reflète rien d’autre que de
mauvais calculs, écrit encore Paul Krugman sur son blog.
( 09 ) Si c’est vrai, c’est plus qu’embarrassant pour
"Reinhart & Rogoff". Mais les vrais coupables sont tous ceux qui
se sont emparés de ce résultat controversé, ne
sachant rien des recherches, parce qu’il disait ce
qu’ils voulaient entendre.»
Leur
défense
Reinhart et
Rogoff n’ont pas tardé à réagir à
l’article accusant leur travaux. Dans une réponse
publiée par le Financial Times,
( 10 )
ils nient avoir volontairement écarté certaines
données. Les économistes reconnaissent toutefois une
erreur dans l’utilisation du tableur Excel,
produisant des «changements notables dans le taux de
croissance moyen de pays endettés à plus de 90%».
Dans une autre réponse, ils assurent relever une
«corrélation», et non une causalité, entre dette et
faible croissance».
|
|
Sur le
fond, cependant, Reinart et Rogoff tiennent bon.
Selon eux, leurs contradicteurs «trouvent eux-mêmes
de plus faibles croissances lorsque la dette est
supérieure à 90%».
A voir.
Certes, selon le trio Herndon-Ash-Pollin,
la croissance moyenne est de 4,2% dans les pays
endettés à moins de 30%, et de 2,2% seulement dans
les pays endettés à plus de 90%. Mais même ce
dernier chiffre est largement supérieur au -0,1%
trouvé par Reinhart et Rogoff. En d’autres termes,
les effets de l’endettement sont bien moindres
qu’imaginés, ce qui fait de sa réduction un objectif
beaucoup moins pressant.
L'épisode est un nouveau coup dur aux théories
soutenant l'austérité à tout crin. Pas sûr cependant
qu'il suffise à y faire renoncer les gouvernements
déjà engagés sur cette route cahoteuse.
|
Sources:
Libération
pour Edouard de Rothschild,
New York Time
pour Arthur Ochs Sulzberger Jr. |
Choix de photos,
fusion de textes, mise en page,
références et titrage
par :
JosPublic
Publication :
27 octobre 2013 |
Ci-dessous:
des textes en lien direct avec le sujet:
|
|