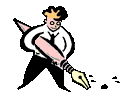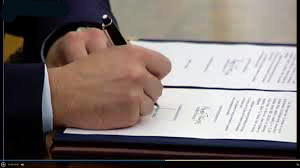|
La seule couleur qui perçait l'obscurité du bar de l'hôtel était celle du liquide ambré scintillant dans son verre. Je me suis approché et il a levé les yeux pour m'accueillir d'un hochement de tête avant de replonger son regard dans son whisky. Je me suis affalé dans le canapé moelleux, épuisé. Sur le moment, sa voix, si familière, était à la fois imposante et sinistre. - Yanis, dit-il, vous venez de commettre une grave erreur. Au printemps, au coeur de la nuit, une douceur difficile à imaginer la journée se déploie sur Washington DC. À mesure que les politiciens, les lobbyistes et les parasites se dispersent, la tension de l'air s'allège. Les bars s'offrent alors aux rares personnes qui n'ont pas besoin de se lever à l'aube et aux plus rares encore que leurs responsabilités empêchent de dormir. Cette nuit-là, comme les quatre-vingt-une-nuits précédentes et les quatre-vingt une qui allaient suivre, j'étais de ceux-là.
C'était le 16 avril 2015, au beau milieu de mon bref mandat de ministre des Finances de la Grèce. Six mois plus tôt à peine, je menais une vie normale, celle d'un professeur d'université enseignant à la Lyndon B. Johnson School of Public Affairs de l'université d'Austin (LBJ), au Texas, détaché de l'université d'Athènes.
Souriant pour pallier l'humour froid de mon interlocuteur et dissimuler mon appréhension, j'ai tout de suite pensé: C'est comme ça qu'il compte venir m'interdire de lutter contre un empire d'ennemis ? Je me consolais en me rappelant que le soixante et onzième secrétaire d'État au Trésor des États-Unis et le vingt-septième président de Harvard n'était pas connu pour son style affable. Déterminé à retarder les affaires sérieuses qui nous attendaient, j'ai fait signe au barman de m'apporter un verre de whisky et je lui ai dit: - Avant que vous précisiez ce que vous entendez par «erreur», permettez-moi de vous dire, Larry, que vos messages de soutien et vos conseils m'ont été très précieux ces dernières semaines. Je vous suis profondément reconnaissant. D'autant que, depuis des années, je vous appelle le Prince des ténèbres. - Au moins m'accordez-vous le titre de prince. J'ai eu droit à pire, répondit Larry Summers, imperturbable.
Il sous-entendait que tout accord signé avec mon pays devait pouvoir être présenté par la chancelière allemande à ses électeurs comme si c'était son idée à elle, son legs personnel - et je le rejoignais sur ce point. Les choses se passaient mieux que je ne l'avais pensé. Nous étions largement d'accord sur l'essentiel, et ce n'était pas rien d'avoir le soutien du formidable Larry Summers dans ce combat contre des institutions, des gouvernements et des conglomérats de médias puissants qui exigeaient la reddition de mon gouvernement, voire, si possible, ma tête sur un plateau d'argent. À la fin, après avoir accordé nos violons pour les prochaines étapes, et avant que l'alcool et la fatigue aient raison de nous, Summers a plongé ses yeux dans les miens et m'a posé une question tellement étudiée que je l'ai soupçonné de l'avoir testée sur d'autres: - Il y a deux types de politiciens. Ceux qui en sont, les imbriqués, et ceux qui n'en sont pas, les exclus. Les seconds privilégient leur liberté de parole pour donner leur version de la vérité. Le prix de cette liberté, c'est d'être ignoré par les imbriqués, qui prennent les décisions importantes. Les imbriqués ont un principe sacro-saint: ne jamais se retourner contre leurs pairs et ne jamais dire ce qu'ils font ou disent aux autres. Quel est l'avantage ? L'accès aux informations confidentielles et la possibilité, non garantie, d'avoir une influence sur des personnages et des dénouements essentiels. Alors, Yanis, à quel groupe appartenez-vous ?
N'ayez aucune crainte, Larry: je jouerai naturellement le jeu aussi longtemps qu'il le faudra pour obtenir un accord viable - pour la Grèce, donc pour l'Europe. Mais si les imbriqués avec qui je négocie se révèlent incapables de libérer la Grèce de cette éternelle servitude, je n'hésiterai pas à devenir un lanceur d'alerte - à reprendre ma liberté, qui est mon habitat naturel. - Je comprends, dit-il après un instant de réflexion. Il était temps d'y aller. Le ciel avait commencé à déverser des trombes d'eau pendant que nous discutions. Je l'ai accompagné jusqu'à ce qu'il trouve un taxi, le temps de me faire tremper par l'averse printanière. Sa voiture a filé, et j'ai pu réaliser un de mes vieux rêves, qui m'avait aidé à supporter les interminables réunions des jours et des semaines précédentes: marcher seul, incognito, sous la pluie.
Les politiques économiques de la zone euro étaient non seulement épouvantables pour la Grèce, mais terrifiantes pour l'Europe, donc pour les États-Unis. Il savait aussi que la Grèce était un laboratoire: ces politiques vouées à l'échec y étaient testées avant d'être appliquées ailleurs en Europe. Voilà pourquoi Summers nous tendait la main. Nous parlions la même langue économique, en dépit de nos différences idéologiques et politiques, et nous n'avions aucune difficulté à nous accorder sur les objectifs à atteindre ni sur les tactiques à adopter. Il n'empêche, ma réponse l'avait gêné, même s'il n'avait rien laissé transparaître. Mon petit doigt me disait qu'il serait monté dans son taxi avec beaucoup plus d'entrain si j'avais fait preuve d'un peu plus d'intérêt pour «en être». Comme la publication de ce texte l'atteste, il y avait peu de chances que cela arrive. De retour à l'hôtel, alors qu'il me restait deux heures à peine avant que le réveil ne me somme de retourner sur la ligne de front, je réfléchissais, angoissé, tout en me séchant: comment mes petits camarades, chez moi, au gouvernement, auraient-ils répondu à la question de Summers en toute sincérité? Cette nuit-là, j'étais déterminé à croire qu'ils auraient répondu comme moi. Moins de deux semaines plus tard, j'ai commencé à avoir de sérieux doutes.
Le 29 août 2012, Yiorgos Chatzis fut déclaré disparu. Il avait été vu pour la dernière fois dans une petite ville du nord de la Grèce appelée Siatista, où il avait appris que son allocation d'invalidité mensuelle de 280 euros (446 dollars canadiens) avait été suspendue. Les témoins ont dit qu'il n'avait pas eu un mot pour se plaindre. « Il était hébété et sans voix », écrirait plus tard un journal. Peu après, il prit son portable pour appeler sa femme. Comme elle ne répondait pas, il laissa un message: « Je me sens inutile. Je n'ai plus rien à t'offrir. Veille bien sur les enfants. »
Mais au Renflouistan, le nom satirique que j'ai donné à la Grèce poste-2010, nos huissiers gardent leurs distances de leurs victimes, se barricadent dans des hôtels cinq étoiles, filent en convois automobiles et se calment les nerfs grâce à des projections statistiques infondées qui seraient la preuve d'un redressement économique. Toujours en 2012, trois longues années avant que Larry Summers ne m'explique la différence entre ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas, ma compagne, Danaé Stratou, présentait dans une galerie du centre d'Athènes une installation intitulée: Il est temps d'ouvrir nos boîtes noires! C'était une immense figure géométrique composée de cent boîtes métalliques noires disposées sur le sol. Chacune d'elles contenait un mot que Danaé avait sélectionné parmi les centaines que les Athéniens lui avaient envoyés sur les réseaux sociaux pour répondre à sa question: « En un seul mot, de quoi avez-vous le plus peur, ou que tenez-vous à préserver plus que tout ? »
Quand une dépression s'aggrave, que les raisins de la colère gonflent et « sont prêts pour la vendange », la source de désespoir la plus profonde est la perte de dignité. J'avais rédigé un texte pour le catalogue de l'exposition dans lequel j'évoquais un autre type de boîte noire. En ingénierie, une boîte noire est un dispositif ou un appareil dont le mécanisme intérieur nous semble opaque, mais dont nous comprenons et utilisons couramment le fonctionnement, qui consiste à transformer ce qui l'alimente, l'input (intrant), en énergie, output (extrant). Un téléphone portable transforme le toucher de nos doigts en un coup de fil ou en l'apparition d'un taxi: cela dit, pour la plupart d'entre nous, sauf les ingénieurs en électricité, ce qui se trame dans un Smartphone (téléphone dit intelligent) est un mystère. Comme les philosophes l'ont souvent remarqué, le cerveau d'autrui est la quintessence de la boîte noire: nous n'avons aucune idée précise de ce qui s'y passe. Mais il y a aussi ce que j'appellerais des « super-boîtes noires », dont la taille et l'importance sont telles que même ceux qui les ont créées et les supervisent n'en comprennent pas le mécanisme intérieur.
Eux aussi transforment une alimentation - argent, dettes, impôts, votes - en énergie - profit, dettes plus élaborées, réduction des prestations sociales, politiques de santé publique et d'éducation. La différence entre ces super-boîtes noires et un modeste téléphone intelligent - voire un autre être humain -, c'est que la majorité d'entre nous contrôle très peu de cette alimentation, tandis que l'énergie qu'elle produit donne forme à nos vies. Cette différence se résume en un seul mot: pouvoir. Non pas le pouvoir que nous associons à l'électricité ou à la force inouïe des vagues de l'océan, mais un pouvoir plus subtil, plus sinistre: celui que détiennent « ceux qui en sont », les imbriqués, comme les appelle Larry Summers. Le pouvoir dont il avait peur que je ne sois pas disposé à l'embrasser: le pouvoir de l'information secrète. Si la dégradation de nos conditions de vie peut être imputée à une conspiration, ses acteurs ne savent même pas qu'ils y participent. Ce qui pour beaucoup s'apparente à un complot réunissant les grands de ce monde n'est autre que la propriété émergent de n'importe quel réseau de super boîtes noires.
Les clés de ce type de réseau sont l'exclusion et l'opacité. Souvenez-vous de la devise de Wall Street et de la City avant l'implosion financière de 2008: Greed is great («vive l'appât du gain»). Beaucoup d'honnêtes employés de banques étaient écoeurés par ce qu'ils faisaient et voyaient autour d'eux. Malheureusement, quand ils mettaient la main sur des preuves ou des informations présageant de conséquences terrifiantes, ils se retrouvaient face au dilemme de Larry Summers: le révéler aux outsiders et se tirer une balle dans le pied; garder le secret et devenir complices; ou profiter de leur pouvoir en échangeant ces informations contre d'autres détenues par un collègue bien au courant, créant ainsi une double alliance qui donnerait un sacré coup de fouet à l'influence de chacun au sein du vaste réseau des imbriqués. À mesure que de nouvelles informations sensibles s'échangent, ce type d'alliance à deux établit des liens avec d'autres alliances similaires. Il en résulte un nouveau réseau de pouvoir au sein de réseaux préexistants, mettant en jeu des participants qui conspirent de facto, même si ce n'est pas consciemment.
C'est ainsi que des réseaux de pouvoir contrôlent le flux de l'information: en cooptant ceux qui n'en sont pas et en excluant ceux qui refusent de jouer le jeu. Ils évoluent de façon organique et sont alimentés par une force supra-intentionnelle qu'aucun individu ne saurait maîtriser, pas même le président des États-Unis, ni le PDG de Barclays, ni les personnes qui occupent les postes clés du Fonds monétaire international (FMI) ou des gouvernements nationaux. Une fois pris dans la toile du pouvoir, il vous faut une étoffe de héros pour vous transformer en lanceur d'alerte, surtout si vous n'arrivez pas à entendre votre propre voix dans la cacophonie de cette immense machine à sous. Les quelques personnes qui rompent les rangs finissent comme des étoiles filantes, vite oubliées par un monde devenu dingue. Paradoxalement, les imbriqués, surtout quand leurs liens avec le réseau sont moins forts, sont inconscients de la toile qu'ils contribuent à tisser, parce qu'ils ont peu de contacts avec elle. De même, ceux qui font partie du réseau y sont trop profondément intégrés pour voir qu'il existe un monde extérieur. Rares sont ceux qui ont assez de discernement pour être conscients de la boîte noire dans laquelle ils vivent et travaillent. Larry Summers est de ceux-là. Sa question revenait à m'encourager à dire non à l'attrait de l'extérieur. Son système de croyance s'appuyait sur la conviction qu'on ne peut changer le monde que de l'intérieur de la boîte noire. C'est là qu'il se trompait, pensais-je, et dans les grandes largeurs.
La foi aveugle de Summers, persuadé que les remèdes à la crise émergeraient de ces mêmes réseaux, brisés, grâce aux opérations habituelles des imbriqués, était d'une naïveté presque touchante. Fallait-il s'en étonner ? Trois ans plus tôt, j'avais écrit dans le catalogue de Danaé: «Ouvrir ces super-boîtes noires est devenu urgent si nous voulons permettre à l'honnêteté, à des populations entières et à notre planète de survivre. Autrement dit, nous n'avons plus d'excuses. Il est donc temps d'ouvrir ces boîtes noires!» En pratique, qu'est-ce que cela implique?
Le temps d'entrer dans mon bar de Washington, trois ans plus tard, j'avais mis de l'eau dans mon vin. Ma priorité n'était plus de transmettre des informations aux outsiders, mais de tout faire pour sortir la Grèce de sa prison pour dettes. Peu importait s'il fallait prétendre en être. En revanche, si le prix d'admission dans le cercle des imbriqués était d'accepter l'incarcération permanente de la Grèce, je claquerais la porte. Dérouler un fil d'Ariane dans le labyrinthe des imbriqués et être prêt à le suivre jusqu'à la libération était une condition non négociable pour préserver la dignité et le bonheur du peuple grec, en tout cas à mes yeux.
Le beau laïus de Larry sur l'importance d'en être et son avertissement selon lequel nous étions en train de perdre la guerre de la propagande se rejoignaient brusquement. Il fallait s'y attendre. Ceux qui en sont, écrivais-je en 2012, réagiraient violemment contre quiconque oserait révéler leur super-boîte noire aux autres: «Ce ne sera pas facile. Ces réseaux réagiront violemment, s'ils n'ont pas déjà commencé. Ils seront plus autoritaires, plus fermés, plus fragmentés. Ils seront de plus en plus jaloux de leur "sécurité" et de leur monopole de l'information, et plus défiants vis-à-vis du peuple. »
À vrai dire, ma signature était importante pour une raison inattendue: ce ne sont ni les présidents ni les Premiers ministres des pays déchus qui signent les accords de prêt avec le FMI ou l'Union européenne. Ce privilège empoisonné revient à l'infortuné ministre des Finances. Aux yeux des créanciers de la Grèce, il était donc vital que l'on m'oblige à plier, que je sois coopté, ou alors broyé et remplacé par un ministre plus conciliant. Si j'avais signé, un nouvel exclu serait devenu imbriqué, et j'aurais eu droit à un concert de louanges plutôt qu'au torrent d'adjectifs ignobles que la presse internationale a déversés sur moi un peu plus d'une semaine après mon rendez-vous à Washington, conformément à ce que le fonctionnaire m'avait prédit. J'aurais été qualifié de « responsable », de « partenaire fiable », de « franc-tireur ayant su se réformer » et placer les intérêts de la nation au-dessus de son « moi narcissique ». De mon côté, j'avais compris qu'il voulait m'aider à obtenir un accord viable. Et qu'il ferait ce qu'il pourrait pour cela, à condition de ne pas enfreindre sa règle d'or: les imbriqués ne se retournent jamais contre leurs pairs, et ne révèlent rien aux exclus de ce que font ou disent les imbriqués. Mais il y avait une chose dont je n'étais pas sûr: arriverait-il enfin à comprendre pourquoi il n'y avait aucune chance pour que je signe un nouvel accord de prêt que je jugeais non viable ? Exposer mes motivations eût été trop long. Et, même si nous en avions eu le temps, nos romans familiaux sont sûrement trop différents pour que mon raisonnement ait du sens à ses yeux. Finalement un ministre des finances grec a signé et ce n'était pas Yanis Varoufakis. Il a dit vrai, n'est pas un imbriqué et n'a pas signé la reddition de mort économique de son peuple - JosPublic
Ci-dessous: des textes en lien direct avec le sujet:
|